L’aide pour le commerce et l’insertion dans l’économie mondiale : Cas de la convention de Lomé
|
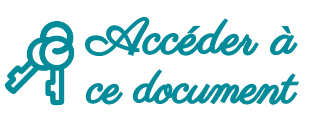
|
• Type de document : Thèse de doctorat
• Nombre de pages : 402
• Format : .Pdf
• Taille du fichier : 2.26 MB
|
Extraits et sommaire de ce document
L’objet de la présente thèse est l’étude de l’efficacité de l’aide par le commerce. Pour mener cette analyse nous avons choisi le cas des offres de préférences commerciales non réciproques des pays industrialisés au profit des pays en développement. Notre cadre de travail est la convention de Lomé. Le principe de base des préférences non réciproques est de permettre aux pays bénéficiaires d’exporter leurs produits éligibles vers le marché du pays offreur, à des tarifs avantageux. L’insertion des pays bénéficiaire dans l’économie mondiale se fait ainsi à travers l’ouverture des marchés des pays offreurs de préférence et de leur capacité à capitaliser cette position avantageuse pour accumuler de l’expérience en termes de progrès technique, de diversification et de compétitivité. Cette insertion, si elle est réussie, doit aboutir à la fin de cette forme d’aide. Ainsi, l’efficacité de l’aide par le commerce peut se mesurer par sa durée. Le cadre d’analyse : Notre contribution sera d’analyser les différents aspects de cette forme d’aide commerciale pour essayer de mettre en évidence ses insuffisances. Ceci nous permettra d’émettre quelques explications sur les raisons pour lesquelles les résultats obtenus à travers ce système d’aide n’ont pas été à la hauteur des espérances. Pour cela nous avons examiné la littérature produite dans ce domaine. Plusieurs arguments ont été évoqués aussi bien pour décrire ses aspects positifs que ses limites. En effet, sur le plan conceptuel, on peut s’attendre à ce que, du fait même d’une croissance des possibilités d’exportation qu’elle peut provoquer, l’offre de préférence permette de générer des revenus pour le pays bénéficiaires. Ces revenus pourront ainsi être investis dans une politique de diversification et de réallocation de la part du pays préféré. Par ailleurs du fait de ces possibilités d’exportation à des tarifs avantageux pour les produits éligibles, l’offre préférentielle augmente l’attractivité des pays bénéficiaires de préférence en termes d’investissement direct. Cependant, ces avantages ne doivent pas faire oublier quelques uns des effets pervers de ces schémas d’aide. En effet, comme le soulignent certains auteurs, l’existence d’offre de préférence peut être à l’origine d’une forte concentration des exportations au profit des produits éligibles, créant ainsi un déséquilibre dans l’allocation des ressources. A cela s‘ajoute l’absence d’efforts en terme de compétitivité de la part des gouvernements des pays bénéficiaires, du fait de l’existence d’une situation de rente provoquée par la présence des préférences. Or cette compétitivité constitue un des principaux moyens d’une insertion réussie dans l’économie mondiale. Afin de vérifier les arguments développés dans la littérature, et de trouver une explication à la faiblesse des résultats obtenus par les pays bénéficiaires de préférence, nous avons entrepris une démarche empirique avec comme cadre d’analyse, la convention de Lomé. L’analyse empirique : Nous avons choisi d’utiliser le modèle de gravité que nous avons appliqué à des données de panel sur une période de 29 années, afin de tenir compte aussi bien de la dimension longitudinale que transversale. Pour cette analyse nous avons utilisé un échantillon composé d’un groupe de PED et d’un groupe de pays industrialisés. Soit un total de 122 pays Dans un premier temps, les différentes approches par coupes transversales ont données des résultats semblables. L’appartenance à Lomé n’a pas été un facteur positif pour le commerce entre les pays en développement de notre échantillon et le groupes de pays développés. Par contre, l’influence des facteurs historiques tels que la langue commune et le passé colonial commun liant l’UE à notre échantillon de PED restent importants toute choses égales par ailleurs. L’appartenance à l’Asie en développement est devenue un facteur positif pour le commerce entre les Pays industrialisés et les PED de notre échantillon, après contrôle des autres variables. Dans un deuxième temps nous avons mené des analyses longitudinales sur 29 années. Elles ont confirmé une partie des résultats des approches par coupes transversales. Cependant, comparée aux autres accords régionaux pris comme témoins (CBI, Sparteca et Caribcan), Lomé semble avoir un impact positif. Mais, l’appartenance aux groupes de PED d’Asie et d’Amérique Latine favorise les échanges avec les pays développés de notre échantillon toutes choses égales par ailleurs.
L’interprétation des résultats : L’objectif de la préférence commerciale est l’acquisition de la compétitivité et de l’autonomie du pays bénéficiaire. Nous avons donc choisi l'insertion dans le commerce mondial comme moyen de mesurer l'efficacité de cette forme d’aide et avons pris comme cadre les préférences de Lomé. Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour mesurer l’insertion. Nous avons choisi le flux des échanges comme instrument de mesure. Mais le choix des seuls échanges entre l'UE et les pays signataires de Lomé ne nous donnerait pas la mesure du degré d'insertion. Ce degré ne se mesure pas dans l'absolu mais par rapport à d'autres pays ou d'autres régions. Autrement dit, il ne se mesure pas sur le seul marché européen mais à l’échelle mondiale. C’est donc pour ces raisons que nous avons introduit d’autres groupes de pays (pays développés et PED). Le choix de l’équation de gravité appliqué aux données de panel nous a permis d’élargir notre champ d’analyse sur un longue période et au delà de la seule relation UE-ACP. Les résultats semblent confirmer les réserves précédemment émises par une grande partie de la littérature. L’offre de préférence, si elle n’est pas accompagnée d’une recherche de compétitivité et d’une plus grande diversification aussi bien des exportations que des partenaires commerciaux, ne permet pas au pays bénéficiaire de réussir son insertion dans l’économie mondiale. Or l’existence d’une offre préférentielle, du fait qu’elle assure un débouché aux produits éligibles, ne semble pas encourager la recherche de gains de productivité, ni une politique de diversification. La situation de rente qu’elle provoque indirectement peut contribuer à une forte concentration de la production. Il semble donc que l’offre de préférence ne soit pas une condition suffisante.
Introduction : A l’origine, les accords préférentiels étaient réciproques et entraînaient une réduction bilatérale des tarifs. Le Zollverein allemand1 du 19ème siècle était déjà fondé sur le principe de préférence réciproque. Dans l’histoire économique de la France, le niveau de protection a connu plusieurs phases. Après avoir atteint des niveaux élevés sous la Restauration, la protection s’est beaucoup réduite sous Louis Philippe et sous le Second Empire. Mais après la défaite de Sedan et la chute du Second empire (1870), on assistera, sous la 3ème République, à un retour vers le protectionnisme en Europe, qui coïncidera en France avec l’obligation de payement à la Prusse de l’indemnité de guerre et l’instauration des tarifs Méline de 1892 (Guillaumet (2002), Braudel et Labrousse (1993), Brasseul, 1997 et 1998). Au niveau européen, plusieurs traités ont été signés et allaient dans le sens d’une libéralisation commerce. Cette libéralisation, tout comme l’instauration de la paix entre nations, étaient considérées comme les catalyseurs de la richesse et du progrès technique.
Le Traité de navigation et de commerce d’Utrecht de 1713 préconisait la réduction des tarifs douaniers et la non discrimination entre les grands pays européens de l’époque que sont la Grande Bretagne, la France et les Pays Bas. Le Traité Eden – Rayneval 3 de 1786 réduit les obstacles au commerce entre la France et la Grande Bretagne4. Ce traité était favorisé par la période de paix et une volonté de lutter contre la contrebande en réduisant les droits de douane. Cette ouverture entraina une hausse globale des recettes de l’Etat et une baisse des dépenses de surveillance des frontières. Il permettait aussi de stimuler l’effet de rattrapage de l’industrie française par rapport à la Grande Bretagne. Mais la guerre qui a repris entre la France et la Grande Bretagne dès 1793 conduira à la fin du traité. (Guillaumet (2002), Bairoch (1993 et 1997).
Le Traité Cobden – Chevalier de 18606 entre la Grande Bretagne et la France sera l’occasion de militer pour l’approfondissement des liens commerciaux comme sources de paix et de richesses entre nations. Ce traité, toujours dans la lignée du libre échangisme, aura une influence réelle sur le reste de l’Europe. Plus tard, en 1932 le Royaume-Uni conclut les accords d'Ottawa avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En 1937 il signa l'accord de commerce bilatéral avec le Canada. Dans ces deux accords, il réserva un traitement préférentiel à certaines importations en provenance des Dominions, non pas sous la forme de préférences tarifaires, mais sous forme de préférence quantitative. Il levait ainsi les restrictions quantitatives qu'il imposait habituellement à ces types d'importations. (OMC, 1992). Au lendemain de la Seconde Guerre, il était alors admis l’idée selon laquelle le maintien de la paix passe par une plus grande coopération économique internationale. C’est ainsi que furent lancées les négociations internationales sur l’Organisation internationale du commerce (OIC) destinée à œuvrer pour une réduction des barrières en 1948 consacrée par la charte de la Havane, mais avortée, faute de ratification par de grands pays dont les USA qui souhaitèrent garder leur souveraineté économique. Et plus tard en 1964 la création de la CNUCED et l’idée d’un Système de Préférence Généralisé non réciproque (SGP, mis au point en 1970) contribuèrent à la prise en compte du commerce comme vecteur de l’insertion des pays en développement dans l’économie mondiale. C’est donc en 1947 que fut fondé le GATT institution non dotée du statut d'organisation internationale. De 23 parties contractantes à l’origine il en comptait, avant son remplacement par l’OMC en 1995, 123.
Le cadre des relations commerciales internationales est aujourd’hui défini par l’OMC. Les obligations de bases des parties contractantes sont fondées sur les principes de la réciprocité, de la transparence des politiques commerciales, de la révocabilité des concessions tarifaires, de la primauté de la clause NPF (article I). Mais des exceptions ont été ajoutées à ces règles fondamentales. En effet l’article XXIV autorise la formation de zones de libre échange ou d’unions douanières qui, de fait, dérogent au principe de non discrimination. De même, l’octroi de préférence non réciproque comme le SGP, une autre exception à la clause NPF, constitue une forme d’assouplissement des règles de base. C’est dans le même sens qu’après sa création, le GATT avait accepté des dérogations pour les organisations qui lui étaient antérieurs : Ce fut le cas des systèmes préférentiels du Commonwealth, de la Communauté française liant la France et ses anciennes colonies, des Pays Bas avec l’Indonésie, de la Belgique avec le Congo. D’autres exceptions, tels que l’accord multifibre (AMF) ou le domaine agricole, ont fait ou font encore l’objet de discorde entre nations. Le cas actuel du textile chinois en est un exemple. En dehors du SGP plusieurs autres offres de préférences non réciproques ont vu le jour avec l’autorisation de l’OMC. Plus généralement les accords d’intégration économique constituent autant d’exceptions à la clause NPF, en vertu de l’article XXV-5 (Il s'agit de la procédure waiver). Le but initial de ces mesures préférentielles étant de favoriser le décollage économique des pays bénéficiaires, on pourrait se poser la question de son efficacité lorsqu’on constate que la plupart des PED ayant fondé leur croissance et leur bien être sur l’existence de ce type d’accord n’ont pas enregistré les résultats escomptés. On peut aussi se demander comme le font de plus en plus les populations de pays bénéficiaires des offres de préférence, s’il est rationnel de fonder la prospérité d’une nation sur la seule bonne volonté et l’abnégation de pays tiers. Le SGP est devenu l’étalon standard du « minimum préférentiel ». Autrement dit en tant que système préférentiel non réciproque de base il est par nature plus avantageux que la clause NPF. Cependant, il existe à côté du SGP beaucoup d’autres systèmes accordant plus d’avantages et offerts par des pays développés individuels ou en groupement à un ou plusieurs pays choisis. Parmi ces systèmes complémentaires on peut noter la convention de Lomé (1975 – 2000), celle de Cotonou10 dans une certaine mesure, mais aussi d’autres tels que le Caribcan, le Sparteca, la CBI, l’AGOA, The Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA en 2000), Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA en 2002), Everything But Arms (EBA en 2001) etc… La multiplication des offres de préférence de la part des pays développés, fait qu’un Etat en développement peut se retrouver bénéficiaire de plusieurs schémas de préférences dont les niveaux en matière de marge préférentielle, de règle d’origine et de clause de sauvegarde peuvent être différents. Elle peut aussi être source d’inefficacité liée aux interférences entre les instruments des différents schémas. Par ailleurs, pour ce qui concerne l’Europe, cette multiplication des offres de préférences contribue à l’érosion des marges dont peuvent bénéficier les pays les plus favorisés dans la hiérarchie de préférences. Mais cette érosion ne peut constituer la seule explication des résultats médiocres enregistrés par ces pays.
Une bonne partie de la littérature sur les offres de préférence souligne d’ailleurs cette difficulté des pays bénéficiaires de préférence commerciale à atteindre l’objectif de développement et d’insertion dans l’économie mondiale. La vocation d’une offre de préférence est d’être limitée dans le temps. Sa brièveté est le signe d’une insertion réussie du pays bénéficiaire. Cette difficulté des mesures préférentielles à atteindre leur objectif se constate à travers les résultats enregistrés par les pays bénéficiaires durant ces dernières décennies. En effet beaucoup de PED bénéficiaires ne parviennent pas à atteindre l’objectif de bien être de leur population et malgré les conditions souvent très avantageuses de certains schémas de préférence, ces pays continuent de perdre des parts de marché et se marginalisent dans le commerce mondial.
Pour comprendre cette situation nous avons pris le cas de la convention de Lomé qui est un parfait exemple d’une politique d’offre complète de préférence comprenant un ensemble d’instruments d’accompagnement destinés à corriger les effets liés à la vulnérabilité des pays bénéficiaires et aux chocs externes. Elle tranche avec les autres offres de préférences qui pour la plupart d’entre elles se limitent à des réductions tarifaires et des règles d’origine.
On pouvait donc espérer que Lomé, étant donné son exemplarité, devait normalement amener les pays bénéficiaires vers le sentier de la croissance. Or au bout d’une trentaine d’années de coopération, le constat reste décevant. L’offre de préférence de Lomé ne semble donc pas déroger à la règle qu’une bonne partie de la littérature avait anticipée, à savoir la difficulté de rendre efficace les offres de préférence du fait de leurs effets pervers inattendus. Nous avons ainsi introduit une étude comparative entre les pays bénéficiaires de la convention de Lomé et un échantillon de pays en développement de « droit commun ». Le but est d’essayer de voir si l’appartenance à Lomé était source de handicap pour le développement. Dans l’affirmative, nous serons tentés de considérer que la convention de Lomé ne fait pas exception et que les offres de préférence en général ne seraient pas la panacée pour l’aide au développement des pays pauvres. La seule voie semblerait être l’insertion dans l’économie mondiale. On comprendra alors pourquoi la Convention de Cotonou qui remplace désormais les Conventions de Lomé introduit dans ses dispositions un effort d’insertion dans l’économie mondiale de la part des pays membres.
La première partie abordera la notion de préférence commerciale dans son sens général, qu’elle soit réciproque ou non. La deuxième partie tentera de mettre en évidence l’ambiguïté du résultat des offres de préférences non réciproques sur les économies de pays bénéficiaires. La troisième partie décrira l’exemple de préférence commerciale non réciproque à travers le cas de la Convention de Lomé. Dans la quatrième partie nous procéderons à une approche empirique dans le but de trouver une explication de l’échec de l’offre de préférence de Lomé. Cette analyse se fera de façon comparative à travers un modèle gravitationnel mettant en jeu un groupe de pays développés (EU, USA, Canada, Japon, Nouvelle Zélande et Australie) et quatre groupes de pays en développement y compris celui des pays ACP. Il s’agit donc d’une analyse comparative des performances entre les PED de l’échantillon et un groupe de pays ACP. Le choix d’autres pays développés en plus de l’UE nous permet de voir le degré d’insertion de notre groupe de pays ACP dans l’économie mondiale. Cette insertion aurait du être l’objectif final d’un décollage réussi.
Autres documents qui pourraient vous intéresser !
Notre plateforme contient plus de 5000 documents (dont +2500 mémoires et PFE), vous pouvez donc y trouver d'autres documents qui pourraient vous intéresser. Pour effectuer votre recherche cibleé, tapez vos mots clés dans le champ ci-dessous !

